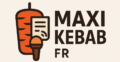Quinze ans à décortiquer les prix dans l’univers alimentaire et de la restauration. La farine, c’est l’ingrédient de base absolu. Celle qui permet de faire le pain, les viennoiseries, les pâtisseries. Son prix reflète notre économie agricole, nos crises, nos tensions sur les matières premières. En 1980, un kilo de farine coûtait quelques francs.
Je vous emmène dans ce voyage à travers 45 ans d’évolution tarifaire. De la farine bon marché des années 80 aux flambées récentes post-Covid, ce produit basique raconte une histoire économique fascinante. Une histoire de céréales, de meuniers, de supermarchés et de guerre en Ukraine.
1980 : la farine accessible
Un prix dérisoire pour un produit de base
En 1980, un kilo de farine de blé type 55 (la plus courante) coûtait environ 1,50 à 2 francs en supermarché. Soit 0,23 à 0,30 euro en conversion directe. Les marques premiers prix tournaient autour de 1,20 franc, les grandes marques à 2 francs. Cette fourchette rendait la farine extrêmement accessible.
La farine appartenait à ces produits qu’on achetait sans réfléchir. Personne ne regardait vraiment le prix. Pour moins de 2 francs, vous repartiez avec un kilo qui permettait de faire plusieurs kilos de pain ou de pâtisseries. Le rendement impressionnait.
Les farines spéciales (complète, de seigle, de maïs) coûtaient un peu plus cher. Comptez 2,50 à 3 francs le kilo. Mais elles restaient dans une gamme très abordable. L’alimentation de base ne ruinait personne en 1980.
Le SMIC comme étalon
Le SMIC horaire s’établissait à 14,79 francs en 1980. Avec une heure de travail au salaire minimum, vous achetiez 7 à 12 kilos de farine selon la gamme. Cette accessibilité totale faisait de la farine un produit quasi gratuit en proportion.
Les familles modestes pouvaient cuisiner maison sans problème. La farine permettait de réaliser des économies substantielles. Faire son pain soi-même revenait bien moins cher qu’acheter en boulangerie. Cette pratique restait courante dans les campagnes.
Les boulangers achetaient évidemment en gros. Leurs prix professionnels descendaient à 0,80 à 1 franc le kilo en sacs de 25 kg. Cette différence avec le prix public restait mesurée. La farine ne représentait qu’une petite partie du coût d’un pain.
Une production française dominante
La France produisait largement de quoi satisfaire sa consommation de blé. Les grandes plaines céréalières (Beauce, Champagne, Picardie) fournissaient les moulins. Cette autosuffisance garantissait des prix stables. Les tensions internationales affectaient peu le marché intérieur.
Les moulins traditionnels côtoyaient les grandes minoteries industrielles. Cette diversité maintenait une certaine concurrence. Les prix ne s’emballaient pas. La farine restait un produit de première nécessité au tarif régulé.
1990 : la stabilité relative
Des prix qui suivent l’inflation
En 1990, un kilo de farine coûtait environ 3 à 4 francs en supermarché. Soit 0,46 à 0,61 euro en conversion. Cette augmentation de 80 à 100% en dix ans suit l’inflation générale. Le pouvoir d’achat farine reste préservé.
Le SMIC horaire passait à 31,94 francs. Avec une heure de travail, vous achetiez toujours 8 à 11 kilos de farine. Le ratio se maintient parfaitement. La farine conserve son statut de produit ultra-accessible.
Les marques de distributeurs se développent durant cette période. Elles proposent des farines à 2,50 à 3 francs le kilo. Cette concurrence des MDD tire les prix vers le bas. Les grandes marques (Francine, Gruau d’Or) maintiennent un premium modeste.
L’industrialisation de la meunerie
Les années 90 voient la concentration du secteur. Les petits moulins disparaissent progressivement. Quelques grands groupes industriels dominent le marché. Cette concentration améliore les rendements mais réduit la diversité.
Les techniques de mouture évoluent. Les cylindres remplacent définitivement les meules de pierre. Cette mécanisation augmente la productivité. Le prix de revient baisse. Ces gains se répercutent partiellement sur le consommateur.
2000 : la veille de l’euro
Des tarifs qui restent sages
En 2000, un kilo de farine coûtait 4 à 5 francs en supermarché. Soit 0,61 à 0,76 euro. Les premiers prix descendaient à 3,50 francs. Cette gamme étendue permettait à chacun de trouver son produit. La farine restait un achat réflexe peu coûteux.
Le SMIC horaire atteignait 42,02 francs (environ 6,41 euros). Avec une heure de travail, vous achetiez 8 à 12 kilos de farine. Le pouvoir d’achat se maintient. Rien ne laissait présager les turbulences à venir.
Les Français consommaient environ 70 kg de pain par personne et par an à cette époque. La farine industrielle dominait largement. Les farines bio ou spéciales restaient confidentielles. Le marché tournait principalement sur la type 55 standard.
2001-2010 : le passage à l’euro
Une conversion plutôt neutre
Le passage à l’euro affecte peu le prix de la farine. En 2001, comptez 0,70 à 0,80 euro le kilo en supermarché. Cette conversion reste honnête. Les arrondis à la hausse restent limités sur ce produit de base. La farine échappe aux dérives tarifaires.
En 2010, le prix oscille entre 0,80 et 1 euro le kilo. Cette augmentation de 15 à 25% en dix ans reste modérée. Le SMIC horaire passe à 8,86 euros. Avec une heure de travail, vous achetez 9 à 11 kilos de farine. Le ratio se maintient parfaitement.
La grande distribution se livre une guerre des prix. Les marques de distributeurs cassent les tarifs. Un kilo de farine premier prix descend à 0,50 euro en promotion. Cette agressivité commerciale bénéficie au consommateur.
L’essor du bio et des farines spéciales
Les années 2000 voient l’émergence des farines biologiques. Elles coûtent 1,50 à 2 euros le kilo, soit le double du conventionnel. Ce segment reste minoritaire mais progresse. Les consommateurs soucieux de qualité acceptent de payer plus.
Les farines spéciales se multiplient. Type 65, type 80, type 110, épeautre, kamut, sarrasin : l’offre se diversifie. Ces produits nichés coûtent 1,50 à 3 euros le kilo. Ils ciblent une clientèle avertie prête à investir dans la qualité.
2020 : avant la tempête
La stabilité trompeuse
En 2020, avant la crise Covid et la guerre en Ukraine, un kilo de farine standard coûte 0,90 à 1,20 euro en supermarché. Les premiers prix tournent autour de 0,70 euro. Les grandes marques atteignent 1,30 euro. Cette gamme reste très accessible.
Le SMIC horaire s’établit à 9,88 euros. Avec une heure de travail, vous achetez 8 à 14 kilos de farine selon la gamme. Le pouvoir d’achat farine n’a jamais été aussi bon. Quarante ans d’amélioration continue des rendements agricoles et industriels portent leurs fruits.
Les Français consomment désormais environ 30 kg de pain par personne et par an. Cette division par deux en vingt ans reflète l’évolution des habitudes alimentaires. Mais la farine garde son statut de produit essentiel. Elle permet de cuisiner maison, pratique qui revient à la mode.
Le premier choc : le Covid
La pandémie de Covid-19 provoque une ruée sur les produits de base. En mars 2020, les rayons de farine se vident. Les Français confinés se mettent à cuisiner massivement. La demande explose. Certains supermarchés rationnent les achats.
Cette pénurie temporaire ne fait pas flamber les prix. Les distributeurs maintiennent leurs tarifs. Mais elle révèle la fragilité du système. La farine redevient un enjeu stratégique. Cette prise de conscience annonce les turbulences à venir.
2022-2025 : l’explosion des prix
La guerre en Ukraine bouleverse tout
En février 2022, la guerre en Ukraine éclate. L’Ukraine et la Russie représentent ensemble 30% des exportations mondiales de blé. Cette guerre provoque un choc d’approvisionnement majeur. Les cours mondiaux s’envolent. Les répercussions sur la farine sont immédiates.
En 2022, le prix de la farine bondit de 30 à 50% en quelques mois. Un kilo qui coûtait 1 euro passe à 1,30 puis 1,50 euro. Les premiers prix grimpent à 1 euro. Cette hausse brutale choque les consommateurs. La farine n’avait jamais connu une telle flambée.
Les causes se cumulent. Le blé explose sur les marchés. L’énergie nécessaire à la mouture coûte plus cher. Les emballages suivent l’inflation générale. Les transports grèvent les coûts. Tous ces facteurs se répercutent sur le prix final.
Les prix actuels en 2025
En 2025, un kilo de farine coûte 1,20 à 1,80 euro en supermarché selon les gammes. Les premiers prix tournent autour de 0,90 à 1 euro. Les grandes marques atteignent 1,50 à 1,80 euro. Les farines bio dépassent 2,50 euros le kilo.
Cette situation marque une rupture historique. Le prix a été multiplié par 2 à 2,5 en cinq ans. Cette explosion dépasse de loin l’inflation générale. La farine perd son statut de produit quasi gratuit. Elle devient un poste de dépense visible.
Le SMIC horaire s’établit à 11 euros en 2025. Avec une heure de travail, vous achetez 6 à 12 kilos de farine. Le ratio se dégrade nettement par rapport aux années 2000-2020. Mais il reste meilleur qu’en 1980. La perspective historique relativise le choc.
Les répercussions en cascade
Cette hausse de la farine impacte toute la chaîne alimentaire. Le prix du pain grimpe de 20 à 30%. Les viennoiseries suivent la même tendance. Les pâtes, autre produit céréalier, explosent aussi. Cette inflation alimentaire pèse lourdement sur les budgets.
Les boulangers subissent de plein fouet cette hausse. Leur coût matière première bondit. Beaucoup peinent à répercuter totalement sur leurs prix de vente. Les marges s’écrasent. Certains établissements ferment, victimes de cette crise.
Les particuliers qui cuisinent maison voient leur budget flamber. Faire son pain soi-même reste économique mais moins qu’avant. L’argument financier s’érode. Seule la qualité justifie encore de s’y mettre.
Tableau comparatif : 45 ans d’évolution
| Année | Prix moyen | Prix 1er prix | Prix bio | SMIC horaire | Nb kilos/h SMIC | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 0,27 € (1,75F) | 0,18 € (1,20F) | – | 2,25 € (14,79F) | 10 kilos | – |
| 1990 | 0,53 € (3,50F) | 0,38 € (2,50F) | – | 4,87 € (31,94F) | 10 kilos | +96% |
| 2000 | 0,69 € (4,50F) | 0,53 € (3,50F) | 1,50 € | 6,41 € (42,02F) | 10 kilos | +30% |
| 2010 | 0,90 € | 0,60 € | 1,80 € | 8,86 € | 11 kilos | +30% |
| 2020 | 1,05 € | 0,70 € | 2,20 € | 9,88 € | 12 kilos | +17% |
| 2025 | 1,50 € | 0,95 € | 2,70 € | 11,00 € | 9 kilos | +43% |
Ce tableau révèle deux phases distinctes. Une stabilité remarquable de 1980 à 2020, où le pouvoir d’achat farine s’améliore même. Puis une rupture brutale entre 2020 et 2025 avec une hausse de 43% qui dégrade le ratio.
Les raisons de l’explosion récente
La guerre et les tensions géopolitiques
La guerre en Ukraine constitue le facteur déclencheur principal. Cette région du monde fournit une part massive du blé mondial. Le conflit perturbe les semences, les récoltes, les exportations. Les stocks mondiaux se tendent. Les cours s’envolent.
Mais d’autres tensions géopolitiques contribuent aussi. Les sécheresses à répétition affectent les grandes zones céréalières. Le Canada, l’Australie, l’Europe connaissent des épisodes climatiques extrêmes. Les rendements baissent. L’offre mondiale se contracte.
Les politiques protectionnistes aggravent la situation. Certains pays limitent leurs exportations pour protéger leurs marchés intérieurs. L’Inde, gros producteur, ferme ses vannes. Cette fragmentation du marché mondial alimente la spéculation. Les prix s’emballent.
L’énergie et les intrants
La production de farine nécessite beaucoup d’énergie. Les moulins consomment de l’électricité en quantité. L’explosion des tarifs énergétiques post-Covid pèse lourd. Ce coût se répercute directement sur le prix de vente.
Les engrais constituent un autre poste majeur. Leur prix a bondi de 100 à 150% en quelques années. Le gaz naturel, matière première de leur fabrication, coûte plus cher. Cette hausse impacte les agriculteurs qui la répercutent sur le blé.
Le transport ajoute sa pierre à l’édifice. Le gasoil a grimpé. Les camions qui acheminent le blé puis la farine coûtent plus cher à faire rouler. Cette inflation logistique se retrouve dans le prix final.
La spéculation
Les marchés à terme sur les céréales connaissent une volatilité extrême. Les fonds spéculatifs parient sur la hausse. Cette dynamique financière déconnecte partiellement les prix de la réalité physique. La farine subit cette financiarisation.
Les industriels et distributeurs anticipent les hausses. Ils constituent des stocks. Cette demande supplémentaire tend encore le marché. Un cercle vicieux s’installe. Chacun anticipe la hausse, ce qui crée la hausse.
Les différentes gammes de farine
La farine blanche standard
La type 55 reste la plus vendue. Elle sert à tout : pain, pâtisserie, sauce. Son prix en 2025 oscille entre 1,20 et 1,50 euro le kilo selon les marques. Cette polyvalence en fait l’incontournable des placards.
La type 45, plus raffinée, coûte légèrement plus cher. Comptez 1,40 à 1,60 euro. Elle sert surtout en pâtisserie fine. Son blancheur extrême résulte d’un raffinage poussé. Cette transformation supplémentaire justifie le surcoût.
Les farines complètes et semi-complètes
La type 65 (semi-complète) coûte 1,50 à 1,80 euro le kilo. Elle contient plus de son, donc plus de nutriments. Cette qualité nutritionnelle séduit les consommateurs soucieux de santé. Le marché progresse régulièrement.
Les types 80, 110 et 150 (complètes et intégrales) atteignent 1,80 à 2,20 euros. Leur production demande des blés de meilleure qualité. Les impuretés éventuelles se concentrent dans l’enveloppe. La sécurité sanitaire impose des contrôles plus stricts.
La farine bio
La farine biologique représente le haut de gamme. En 2025, comptez 2,50 à 3,50 euros le kilo selon le type. Soit le double du conventionnel. Cette différence reflète les surcoûts de l’agriculture bio.
Les rendements bio sont inférieurs de 20 à 30%. Les intrants coûtent plus cher. La certification engendre des frais. Tous ces facteurs expliquent le premium. Mais le marché progresse. Les consommateurs valorisent de plus en plus cette qualité.
Les farines spéciales
L’épeautre coûte 3 à 4 euros le kilo. Cette céréale ancienne revient à la mode. Ses qualités nutritionnelles et son goût séduisent. Mais sa culture marginale explique son prix élevé.
Le sarrasin atteint 4 à 5 euros le kilo. Sans gluten naturellement, il répond à une demande croissante. Mais sa production reste confidentielle. Cette rareté justifie le tarif premium.
Les alternatives pour économiser
Acheter en gros
Les sacs de 5 ou 10 kg permettent des économies substantielles. Le prix au kilo descend de 20 à 30%. Comptez 0,80 à 1 euro le kilo en achetant un sac de 10 kg de marque distributeur. Cette option convient aux familles ou aux gros utilisateurs.
Les magasins de grossistes (Metro, Promocash) proposent des tarifs encore plus serrés. Mais l’accès reste limité aux professionnels ou nécessite une carte. Cette barrière à l’entrée protège les prix de la grande distribution.
Les promotions
Les supermarchés mettent régulièrement la farine en promotion. Les rabais atteignent 30 à 40%. Un kilo à 1,50 euro passe à 1 euro. Faire des stocks lors de ces opérations permet de lisser les coûts.
Les cartes de fidélité donnent accès à des offres spéciales. Certaines enseignes remboursent un pourcentage en bons d’achat. Ces mécanismes réduisent le coût final. Mais ils créent aussi une dépendance aux programmes de fidélisation.
Moudre soi-même
Les moulins domestiques permettent de faire sa farine. Acheter du blé en grains coûte moins cher que la farine. Comptez 0,80 à 1,20 euro le kilo de blé bio. Le moulin représente un investissement de départ de 150 à 500 euros.
Cette solution séduit les puristes. La farine fraîchement moulue offre des qualités gustatives supérieures. Mais elle demande du temps et de l’équipement. Cette pratique reste donc très minoritaire.
Conclusion sur une denrée stratégique
La farine à 0,27 euro en 1980 incarnait l’abondance alimentaire. Ce produit de base ultra-accessible permettait à tous de cuisiner sans compter. Pendant quarante ans, cette situation s’est maintenue. Le pouvoir d’achat farine s’améliorait même progressivement.
Les cinq dernières années ont brutalement changé la donne. La farine à 1,50 euro en 2025 représente une multiplication par 5 à 6 en valeur nominale. Cette hausse récente de 40% en cinq ans marque une rupture historique. La farine redevient un produit visible dans le budget.
Cette évolution révèle notre dépendance aux marchés mondiaux. Une guerre à l’autre bout de l’Europe fait flamber nos prix. Les tensions climatiques pèsent sur les récoltes. L’énergie chère renchérit la production. La farine, produit si simple, concentre toutes les fragilités de notre système alimentaire.
Après quinze ans à observer les prix alimentaires, je tire cette leçon : la farine bon marché était une anomalie historique. Nous avons vécu pendant des décennies dans une bulle d’abondance céréalière. Cette période se termine. Les tensions sur les ressources, le climat, l’énergie s’invitent dans nos placards. La farine à 1,50 euro n’est probablement qu’un début. Adaptons nos habitudes et réapprenons à valoriser ces produits de base trop longtemps considérés comme acquis.